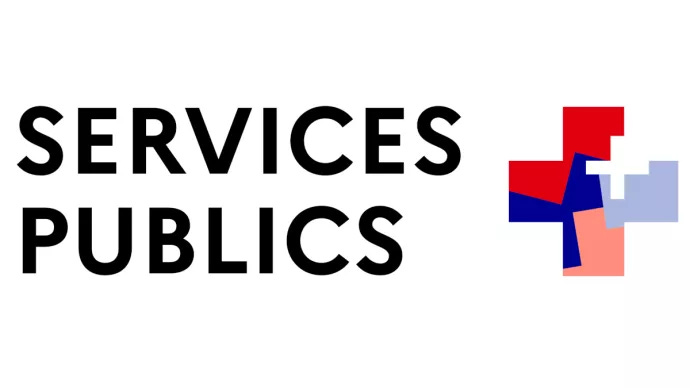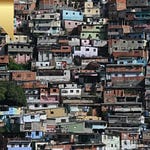STOP aux "services publics" !
La fourniture de biens/services publics par l'État n'est PAS une chance (ni pour vous, ni pour moi).
Démonstration.
Les politiciens ne savent que vendre des illusions et détruire notre richesse. Je préfère vous délivrer des principes pour vous permettre de percer à jour leurs méfaits. Si l’économie vous intéresse et que vous souhaitez enfin vous y former, adhérez à mon cours Six Leçons. Deux voies d’accès vous sont proposées :
▶︎ Le cours à la carte (paiement une fois)
▶︎ L’inscription à l’Académie (niveau “Culture Liberté” ; paiement annuel)
Par avance, bravo pour votre engagement et merci pour votre soutien si précieux !
I. La théorie des biens publics
Pour émettre ma critique des services publics, je me propose de démystifier la théorie des biens publics qui lui sert souvent de soutien intellectuel. Dans un second temps, j'essaierai de vous montrer en quoi la production de biens ou de services publics est un gâchis net pour tous (sauf pour la caste, bien sûr).
Paul Samuelson est l'économiste le plus souvent associé à la formulation moderne de la théorie des biens publics. Son article de 1954, "The Pure Theory of Public Expenditure," est le texte fondateur de cette théorie. Elle repose sur l'idée que certains biens ou services ne peuvent pas être fournis de manière efficace par le marché libre. Cette théorie distingue deux caractéristiques principales des biens publics :
▶︎ Non-rivalité : la consommation d'un bien ou service par une personne n'empêche pas sa consommation par une autre. Le cas de l'éclairage public est bien connu. Une personne qui profite de la lumière n'en prive pas les autres.
▶︎ Non-exclusivité : il est difficile (voire impossible, selon cette théorie) d'empêcher quelqu'un de consommer un bien ou service une fois qu'il est produit. Prenez la défense nationale. On ne peut pas exclure un citoyen de la protection assurée par l'armée, même s'il n'y a pas participé.
Pour Samuelson, le marché est défaillant dans la production de certains biens car ces deux caractéristiques se renforcerait mutuellement pour rendre la production privée non rentable. Voilà le raisonnement qu'il tenait :
▶︎ Non-rivalité : il y aurait ici un gâchis d'efficacité. Pour Samuelson, le dilemme de l'entrepreneur est le suivant :
- Si l'entrepreneur fait payer pour le bien (par exemple, un pont), il va exclure des personnes qui seraient prêtes à l'utiliser. Et comme il prétend que le coût marginal d'un utilisateur supplémentaire est nul, la société perdrait en efficacité car des personnes qui pourraient en bénéficier gratuitement en seront privées.
- Si l'entrepreneur offre le bien gratuitement, il ne pourra pas récupérer le coût de son investissement initial et finira par faire faillite. Il ne pourrait donc pas produire le bien, car le profit serait absent.
▶︎ Non-exclusivité : ici vient le problème du passager clandestin. L'entrepreneur ne peut pas exclure ceux qui ne paient pas. Cela crée un "manque à gagner" qui découragerait l'investissement.
En conséquence, personne ne voudrait financer la production de ces biens/services particuliers, que l'auteur nommait biens publics purs (comme la défense nationale, pour lui du moins). À noter que Samuelson n'étendait pas sa théorie aux biens privés (comme la nourriture ou les vêtements). Sa théorie ne devrait s'appliquer qu'aux biens publics purs en raison de leur nature non-rivale et non-exclusive.
En clair, le profit étant la principale motivation de l'entrepreneur, le manque de rentabilité concernant la production de biens publics purs conduirait à un échec du marché. C'est pour cette raison que Samuelson et les économistes étatistes estiment que seul l'État peut garantir la fourniture de ces biens en passant par la fiscalité. Entamons désormais une réfutation.
II. Les erreurs de la théorie des biens publics
Ces deux caractéristiques et les explications qui vont avec ne tiennent pas la route dès qu'on gratte un peu. Commençons par la non-rivalité, dont l'argumentaire repose sur plusieurs hypothèses qui ne correspondent pas à la réalité du marché. Ainsi, l'argument selon lequel le coût marginal d'un utilisateur supplémentaire est nul n'a pas de sens.
Dans le monde réel, un utilisateur de plus a toujours un coût. L'ajout d'une personne sur un pont peut augmenter les embouteillages, nécessitant une maintenance plus fréquente et des investissements futurs. L'éclairage public a aussi un coût de production et d'entretien qui est supporté par quelqu'un (les contribuables à vrai dire). L'absence de coût est un fantasme.
Par ailleurs, la non-rivalité est intimement lié à l'absence de propriété. Sur un marché libre, les entrepreneurs trouveraient des moyens de s'approprier les ressources et de faire payer leurs biens/services à quiconque est prêt à les acheter. Les entreprises trouvent toujours des solutions pour rentabiliser leur investissement initial, il s'agit de leur raison d'être.
Par exemple, des services de défense ou de transport pourraient être financés par des abonnements payants. Les non-abonnés seraient exclus, rendant le bien rival et exclusif. En fait, l'argument de Samuelson suppose que les entrepreneurs sont incapables d'innover pour surmonter la non-rivalité. Il n'imagine pas le marché, sa nature, sa fonction.
Ce n'est donc pas un argument contre le marché mais une supposition de sa part sur la limitation de la créativité humaine. Sauf qu'au contraire, la réalité du marché montre que les entrepreneurs sont toujours en train de trouver des solutions aux problèmes pour les rendre rentables.
Ma réponse sera identique concernant la non-exclusivité. Ça n'est pas une caractéristique inhérente de certains biens/services, mais un problème de droit de propriété et de marché libre. Ici, la critique de Samuelson porte sur le problème du passager clandestin. Mais encore une fois, ce sont aux entrepreneurs de trouver des moyens de surmonter cette difficulté !
L'argument de la non-exclusivité suppose aussi que les entrepreneurs soient incapables de faire payer tous les utilisateurs ou au moins de ne pas subir trop de clandestinité. Or, un entrepreneur doit toujours trouver de nouvelles manières de monétiser ses biens. Ce n'est toujours pas un argument contre le marché, mais un oubli de la fonction de la propriété privée et une projection sur l'incapacité des entrepreneurs à innover.
Le problème du passager clandestin n'en est donc pas un. Si les entrepreneurs ne peuvent pas faire payer les utilisateurs, c'est parce que l'État ou d'autres institutions qui lui sont liées les en empêchent. Si les droits de propriété étaient respectés, le marché trouverait des solutions car il ne vit que pour cela. Par exemple, une route à péage serait rendue exclusive et rivale (elle serait donc un bien privé).
En plus, le passager clandestin n'est pas forcément un problème, tout dépend du cas de figure. Un entrepreneur peut tolérer des passagers clandestins tant que leur nombre ne nuit pas à sa rentabilité. Le problème naît lorsque son modèle d'affaires est menacé et qu'il se juge perdant. À ce moment-là, la clandestinité devient un problème et l'entrepreneur est incité à trouver une solution.
Prenez l'exemple d'un service de diffusion en ligne comme Netflix. Au début, le partage de mots de passe était toléré car cela ne nuisait pas à la rentabilité de l'entreprise. Il s'agissait bien d'une forme de clandestinité. Cependant, à mesure que le nombre de passagers clandestins augmentait, Netflix a mis en place un système de détection de partage de mots de passe, obligeant les utilisateurs à payer.
Le marché n'a pas de "faille". Ça n'a aucun sens. Le marché est un processus. Le marché, c'est vous. C'est moi. C'est nous. Il reflète nos besoins d'un coté et la capacité des entrepreneurs à innover et faire des profits de l'autre. Alors si une solution n'existe pas, c'est juste que la demande n'existait pas non plus ou que personne n'a encore trouvé un moyen rentable de la produire (et donc, les ressources de l'entrepreneur auront été investies ailleurs).
III. Le problème du gaspillage
La production de biens/services publics (comprenez donc : tout ce qui n'est pas strictement produit par le privé) est un gaspillage net pour la société. Cela se manifeste de plusieurs façons.
▶︎ Destruction de la concurrence
L'État est le monopole de la force légale. Il est ainsi capable de lever l'impôt. Et non seulement il nous spolie à la source, mais en plus il n'a pas de concurrent. De ce fait, il n'a aucune incitation à être efficace, et donc à économiser.
C'est pourquoi l'État se comporte sur la durée en paresseux, se contentant de prélever des impôts sans se soucier du coût ni de l'efficacité de sa production.
▶︎ Le gâchis de ressources
L'État n'est pas une entreprise et ne réalise pas de profits. Rappel que ses recettes ne sont PAS du profit, elles sont au contraire le reflet de la spoliation qu'il organise. Pas de bol, c'est le profit qui motive l'entrepreneur à servir, à innover dans la durée, tout en économisant ses propres ressources.
Sans cette motivation (et cette crainte de faire faillite si les pertes s'accumulent !), l'État n'a donc pas d'incitation à économiser ni à s'améliorer. Tant que les impôts et la dette sont là pour couvrir, il s'en servira malgré nous. Son modèle, c'est le gaspillage.
▶︎ Le manque de choix
L'État est aussi incapable de produire des biens qui correspondent aux besoins individuels. Les services publics sont standardisés, non personnalisés. L'État ne peut donc jamais satisfaire tout le monde. Or, ce manque de choix est une autre perte pour nous...
C'est le marché qui permet la diversité, lui qui est composé d'entreprises en concurrence capables d'offrir une variété quasi infinie de biens/services répondant aux besoins de chaque segment de clientèle.
▶︎ La violence comme coût social
Mais finalement, le plus grand gaspillage de la production de biens/services publics est sans doute la violence engendrée. L'État vole systématiquement les individus et les fournit de moins en moins bien malgré tout. Non seulement cette entité criminelle viole le principe de non-agression à la base, mais en plus elle devient incapable de nous fournir quoi que ce soit qui tienne la route.
Forcément, l'État socialise les coûts mais ne socialise pas les bénéfices. La caste ponctionne, nous subissons. Il n'y a donc aucune incitation à bien nous servir sur le long terme. C'est l'individu qui y perd car il est volé pour des "services" (des monopoles en réalité !) qu'il n'utilise pas/peu ou qui se dégradent dans le temps, sans pouvoir se tourner vers la concurrence.
IV. Libéralisons, vite !
Laissez-moi vous présenter cette ultime partie en 3 points. Il est temps de faire la Liberté !
1. La légitimité
La libéralisation est d'abord un impératif éthique. Il faut toujours rappeler le Droit. Le marché libre est légitime car il se fonde sur le principe de non-agression (NAP), la seule éthique sociale possible car non contraignante et justifiable sans contradiction. De son côté, la production de biens/services par l'État est une violation de la propriété car elle ne peut exister que par l'impôt.
2. La possibilité
La libéralisation est non seulement légitime en Droit, mais aussi possible. Il n'y a pas de défaillance de marché, comme précisé plus tôt dans ce fil. Les notions de non-exclusivité et de non-rivalité ne sont pas des caractéristiques intrinsèques des biens, mais des problèmes d'absence de droits de propriété.
La libéralisation est possible car le marché est un processus créatif qui résout des problèmes en s'appuyant sur l'initiative individuelle, la concurrence et la mécanique des pertes et profits qui veillent à sélectionner les entreprises efficaces (ce qui profite directement aux consommateurs). Le marché peut fournir tous les biens/services qu'il est possible de produire de façon rentable, encore faut-il nous laisser-faire.
3. Les bienfaits
La libéralisation est également bénéfique pour toute la société. Le marché libre crée de la richesse pour tous par l'incitation au profit et le besoin de réduction de ses coûts. Par ailleurs, la concurrence entre entreprises pour attirer les clients génère de la variété, de la qualité et pousse les acteurs en lice à se surpasser.
Mieux encore, la pression concurrentielle force les entreprises à redoubler d'efforts pour attirer des clients. Le profit étant la motivation des entrepreneurs, ces derniers doivent toujours, soit augmenter leurs prix soit réduire leurs coûts. Or, en cas de forte concurrence augmenter sa productivité et réduire ses coûts devient crucial.
La libéralisation pousserait toutes les entreprises à être plus productives, quoi qu'elles fournissent. C'est une règle générale. Ainsi, la qualité augmenterait partout et les prix baisseraient en même temps. Légitimité, possibilité, bénéfices pour tous. Qu'attendons-nous pour libéraliser ? Ah oui, l'État n'est pas d'accord. Qu'il en soit ainsi, nous finirons par le grand remplacer partout là où il s'est révélé défaillant, lui qui l'est par conception.
Récupérez votre diapos :