Aujourd'hui, j'ai passé le #bac2024 de philosophie!
J'ai opté pour la dissertation : "L'État nous-doit il quelque chose ?".
À votre avis, le professeur fera t-il une syncope en lisant ma copie ?
Introduction
Le sujet que j'ai choisi nous invite à réfléchir aux fondements de l'État et à ses devoirs envers les citoyens. Je me propose de poser quelques définitions avant de commencer la dissertation.
État : société politique résultant de la fixation, sur un territoire délimité par des frontières, d'un groupe humain présentant des caractères plus ou moins marqués d'homogénéité culturelle et régi par un pouvoir institutionnalisé.
(En droit constitutionnel, l'État est une personne morale territoriale de droit public personnifiant juridiquement la nation, titulaire de la souveraineté interne et internationale et du monopole de la contrainte organisée.)
Devoir : obligation morale, considérée sous sa forme la plus générale.
Source : Larousse
- - -
Ces définitions semblent bien décrire la réalité, mais que je vais introduire une proposition forte qui guidera toute ma démonstration et qui pourrait vous perturber.
Faites l'effort de rester chers lecteurs, cela pourrait bien vous intéresser. J'affirme que le pouvoir institutionnalisé par l'État est illégitime et source de tous nos problèmes sociaux. Partant de là, la notion même de devoir s'évacue.
Plan
Le fait de poser ou non ce caractère d'illégitimité fait toute la différence dans l'analyse des obligations ou des devoirs de l'État vis-à-vis de nous, individus.
Je vous propose de procéder comme suit :
I. Je vais commencer par décrire la vision de Jean-Jacques Rousseau, la plus largement répandue pour justifier l'État
II. Puis, je continuerai en émettant une critique de cette vision
III. Ensuite, je démontrerai que l'État est un agresseur
IV. Enfin, je vous présenterai une position alternative afin de vous ouvrir à une réflexion novatrice sur le sujet
Bonne lecture à tous !
I. La vision classique de l'État et de ses devoirs
Le point de départ le plus couramment établi pour défendre la vision étatiste est celui du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, stipulant que les citoyens cèdent une partie de leur liberté à l'État en échange de services rendus. Il s'agirait là d'un pacte social.
À l'origine, Rousseau décrit un accord par lequel les individus quittent l'état de nature pour former une société organisée. Dans cet état de nature, les individus vivent sans lois ni institutions. Ils jouissent d'une liberté totale mais ils ne bénéficient d'aucune garantie quant à leur propre sécurité.
Pour échapper à cette insécurité, les individus consentent à un contrat social, acceptant alors de renoncer à une partie de leur liberté naturelle en échange de la sécurité garantie par la nouvelle société organisée et ses institutions. Une fois ce contrat social établi, l'intérêt général devra orienter les décisions politiques pour servir les citoyens.
En principe, il est établi que l'intérêt général est respecté lorsque l'État assure les fonctions dites régaliennes (sécurité, justice, défense des frontières), mais aussi quand il intervient sur le plan économique et social. En effet, l'État doit veiller à l'équilibre des marchés et au bien-être des citoyens. Voilà ce qu'il serait du contrat social et des obligations de l'État.
Une chose est sûre : qu'on parle de la gauche politique ou de la droite politique en France, il est toujours question de degrés d'intervention et de redistribution, comme de préférences variées sur un plan moral. Aucun de ces camps politique (ni toutes leurs déclinaisons en partis) n'ose poser ce diagnostic d'illégitimité de l'État, annulant par la même toute notion de devoir. Venons-en alors à la justification d'une telle affirmation.
II. Critique du contrat social
Décortiquons un peu cette notion de contrat social, si vous permettez qu'on touche à ce veau d'or. J'estime qu'il est une fiction juridique imposée par l'État et non une émergence spontanée ni une société consentie entre individus.
Un contrat, dans son acception la plus commune, est un accord volontaire entre parties prenantes et consentantes. Or, aucun individu adulte et responsable n'a signé volontairement de contrat auprès des hommes de l'État.
Cela n'est pas une simple opinion. C'est un énoncé apodictique, infaillible. Vous n'avez concrètement signé aucun contrat, et moi non plus. Au-delà de l'aspect de la signature, vous ne pouvez pas non plus sortir du (faux) contrat social. Tiens donc ? Aucune clause de sortie de prévue ? Quel drôle d'arrangement social...
Cela équivaut à une prison contractuelle où les individus sont forcés de se conformer à des règles sans possibilité de retrait. En fait, la notion de contrat social masque la réalité de la domination de l'État sur l'ensemble de la société. Elle sert à légitimer l'autorité de l'État et à justifier ses monopoles.
En prétendant que les individus consentent à ce système, l'État peut continuer d'exercer sa violence comme si de rien n'était. Et puisque je parle désormais de violence, il me faut justifier de l'usage de ce terme en ce qui concerne l'État.
III. L'État comme agresseur
Dans cette partie, il me faut poser d'autres définitions pour dérouler mon propos, jusqu'à l'alternative proposée dans la dernière partie. Permettez-moi alors de définir le droit naturel, puis le principe de non-agression.
Droit naturel : droit qui découle de la réalité des échanges humains. Le simple fait que nous argumentions et que nous échangions toute notre vie suppose l'existence de ce droit, qui s'accorde entre les Hommes. Ainsi, le droit naturel est intrinsèque à notre réalité humaine et ne dépend pas des lois d'État pour être valide. C'est une reconnaissance mutuelle.
Cette définition du droit naturel est la plus récente en vigueur. Il est très important de le préciser car de nombreux auteurs du droit naturel ont philosophé après Jean-Jacques Rousseau. Cette définition est notamment utilisée par les libertariens contemporains et cela fera le lien avec ma dernière partie.
Principe de non-agression : absence de coercition envers un individu. La coercition se manifeste par le vol, l'agression ou la menace directe d'agression. Autrement dit, la situation de non-agression est une situation de respect du droit naturel.
Il devient alors évident que l'État, par sa nature coercitive, spoliatrice et monopolistique, est fondamentalement en conflit avec ces principes. À partir de là, j'affirme avec force que l'État est un agresseur par nature.
Que l'on parle de la législation, de la fiscalité ou de la captation de la violence, l'État tout entier repose sur l'absence de consentement. Quand une loi est votée, le droit naturel n'est pas respecté. Quand une taxe est prélevée, le droit naturel n'est pas respecté. Quand la légitime défense et la propriété privée ne sont pas garanties, le droit naturel n'est pas respecté.
Faites le test pour la fiscalité. Ne payez plus vos impôts pendant un certain temps. Esquivez toutes les relances de l'État. Un jour, quelqu'un viendra toquer à votre porte et cela pourrait bien vous faire tout drôle. Vous serez ainsi confronté au principe de réalité : ne pas payer vos impôts vous expose inévitablement à la violence de l'État.
En fait, les obligations que l'État prétend avoir envers nous ne sont qu'une façade. Il cache la coercition sous le tapis pour avancer masqué. Dans cette optique, de nombreux récits seront produits par ceux qui composent l'appareil d'État ou qui travaillent pour lui. Le but étant de nous faire croire que les devoirs de l'État sont bien réels et indispensables à nos vies.
IV. Une alternative nommée liberté
Après avoir démontré que l'État outrepasse le droit naturel et s'impose sur chacun de nous, il est essentiel d'exposer une proposition de société en accord avec les principes que j'ai évoqués. Je tiens à clarifier cette position rapidement. L'alternative de la liberté, qui consiste à revenir au droit naturel et à le faire respecter, ne suppose pas un instant qu'il faille en finir avec les fonctions régaliennes, la société organisée ou la notion de règles sociales.
Non, il s'agit simplement de dire une chose : tout cela doit être réellement consenti. Laissez faire les individus, ce sont des adultes qui savent s'organiser. L'alternative nommée liberté consiste à laisser émerger spontanément la société par le bas, dans le respect du droit naturel et par le libre marché. Creusons un peu plus au coeur cette alternative.
Sur le plan du droit, des acteurs privés qui proposent des services (de toute sorte) ne sont ni des agresseurs ni des monopoleurs. Quand vous achetez un bien ou un service sur le marché, vous n'êtes pas agressé car il y a manifestation de votre consentement. Par ailleurs, aucune entreprise en concurrence ne peut s'arroger de monopole : tout monopole (ou avantage illégitime) est signe d'État. La collusion n'existe que parce que l'État existe.
Sur le plan économique, ma position repose sur cette seule proposition : tout est logique de service dans notre réalité. La loi de l'offre et de la demande existe et se manifeste tout au long de notre vie. La coopération sociale est notre mode de fonctionnement quotidien. Constatez-le par vous-même : toutes nos actions quotidiennes sont tissées d'arrangements consentis.
Ainsi, pourquoi y aurait-il le moindre secteur du réel qui échapperait à cette logique de service et de coopération sociale ? Cela n'a pas de sens : dans le champ économique et plus particulièrement entrepreneurial, tout est question de modèle d'affaires et d'ingéniosité des Hommes pour répondre aux besoins infinis et changeants de l'Humanité.
En fait, ceux qui réclament l'intervention de l'État dans l'économie défendent une vision marxiste et socialiste de la société. Ils estiment que l'économie est source de domination. Je m'oppose radicalement à cette position. En économie, il ne peut jamais y avoir de prédation car toute logique de service suppose un échange gagnant-gagnant, et donc consentement. À cet égard, il est uniquement question d'établir des constats implacables sur les choix humains.
En effet, la vision rationnelle et logique de l'économie nous impose de nous en tenir à l'observation de l'action humaine. Il s'agit de constater que les individus agissent pour s'enrichir et gérer leurs ressources. Or, pourquoi l'enrichissement des individus et la gestion de la rareté des ressources tangibles supposeraient-elles mécaniquement l'intervention de l'État (devoir), alors même que nous avons établi en amont qu'il est un agresseur tandis que l'économie ne relève pas de cette nature ?
Conclusion
L'État ne peut pas nous servir sans violer notre droit naturel en même temps. Comment une entité qui ne respecte pas le consentement des individus pourrait-elle bien les servir et leur devoir quoi que ce soit ?
Seule une société respectueuse du droit naturel peut rendre des services aux individus sans les agresser et faire émerger la notion de devoir. J'ai le devoir de ne pas agresser mon prochain et de rendre les services pour lesquels je me suis engagé avec autrui. Voilà les seuls devoirs réels, loin de la fiction de Jean-Jacques Rousseau et de l'action de l'État.
Si j'étais taquin, et je vais me permettre de l'être pour clôturer cette dissertation, je dirais que l'État nous doit bien quelque chose finalement : il devrait rendre tout l'argent qu'il a usurpé aux productifs et aux membres vivants de leur famille depuis leur naissance, s'occuper lui-même de la dette qu'il a engendrée et laisser la société vivre loin de sa violence. Ainsi, nous reviendrons enfin au droit naturel.



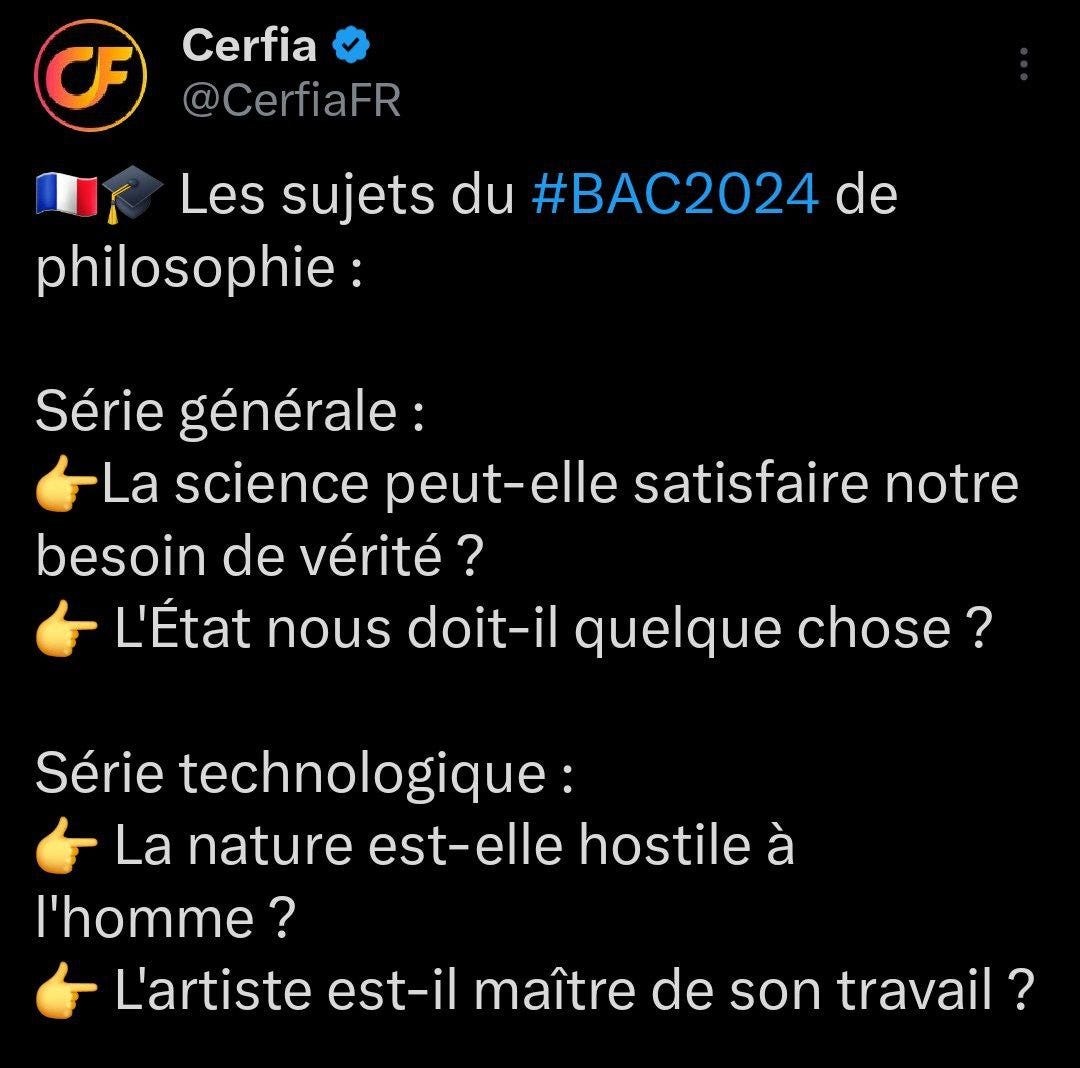


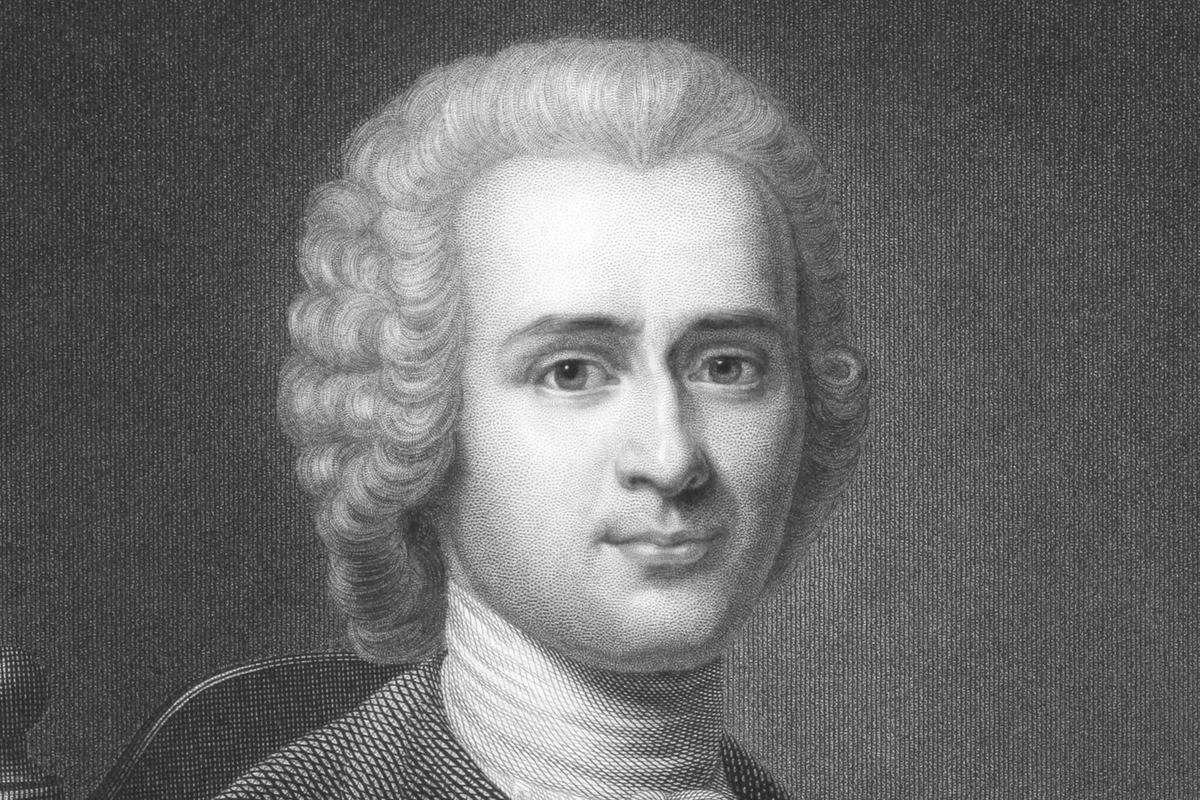



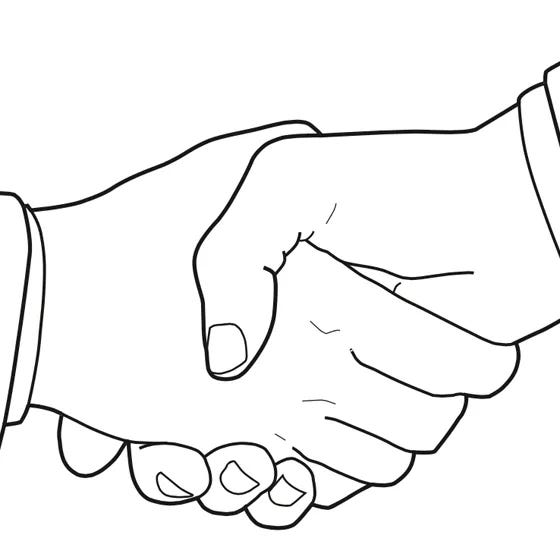
Je pense que l'une des réponses attendues, sinon nécessaires, consiste à retrouver l'idée que l'Etat n'est pas une personne mais une structure juridique produite par l'homme, faite de droits, et que seule une personne peut avoir, à proprement parler, des devoirs.
Ce qui rejoint votre thèse : l'entité transcendante de l'Etat ne saurait jamais être quiconque ou quoi que ce soit d'autre que le sujet libre et responsable. L'Etat ne peut rien devoir à quiconque, pour la bonne raison qu'il n'est pas doué d'agence. Il ne sait pas qu'il a des devoirs, il est aussi irresponsable que n'importe quel agent de l'imagination.
Mais le sujet libre et responsable doit contraindre l'Etat à fonctionner "comme il se doit", comme l'ingénieur et le technicien fabriquent et utilisent une machine, sous la forme de règles pour un jeu, la forme contractuelle. L'agent politique, que nous sommes tous, est responsable de s'assurer que la structure fonctionne selon sa téléologie : de la même façon qu'un individu qui n'a pas d'objectif est certain de ne jamais atteindre ses buts, aucun Etat ne peut se comporter comme il se doit s'il n'est pas administré et contrôlé par des citoyens qui partagent une vision de l'avenir. Le devoir de l'Etat étant celui que les humains se fixent à eux-mêmes, il reste du devoir de chacun de s'assurer qu'il accomplit le sien sans faillir.
Ce que l'État nous doit, ce n'est ni plus ni moins que ce qu'on se doit à soi-même et qui consiste essentiellement à faire ce que l'on doit faire. Si chacun faisait toujours ce qu'il doit faire, plutôt que ce qu'il désire, l'État ne cesserait jamais de permettre de réaliser les devoirs que les citoyens lui ont fixé.
Le danger de la conscience intuitive est que cette dernière a tendance à personnifier les institutions, comme un reste d'animisme, et qu'elle projette dans la chose ce qui appartient à la personne et perd en contrôle du réel ce qu'elle gagne en imagination. Et que les psychologues appellent le transfert du "LOC interne" vers le "LOC externe". Si bien qu'à la fin, il n'est pas rare que la foule regarde l'État comme on regarde Dieu, les yeux dans le vide et le coeur plein d'espoirs, sans bien réaliser le néant humain dans l'objet fabriqué, sans non plus réaliser que cette perte de subjectité ("croire en l'État" comme à une personne, transférer son âme dans un objet de l'imagination) représente déjà un manque au devoir d'être soi, unifié, conscient et responsable, dénué d'illusions sur ce qu'être implique comme devoirs et en particulier être un agent de l'État, le citoyen d'une nation, le garant du droit.
Au final, l'État ne saurait devoir quoi que ce soit à qui que ce soit, au même moment où nombre d'entre nous manquons à nos devoirs en comptant sur l'État pour compenser.
Quel leurre ! Quelle erreur de jugement !