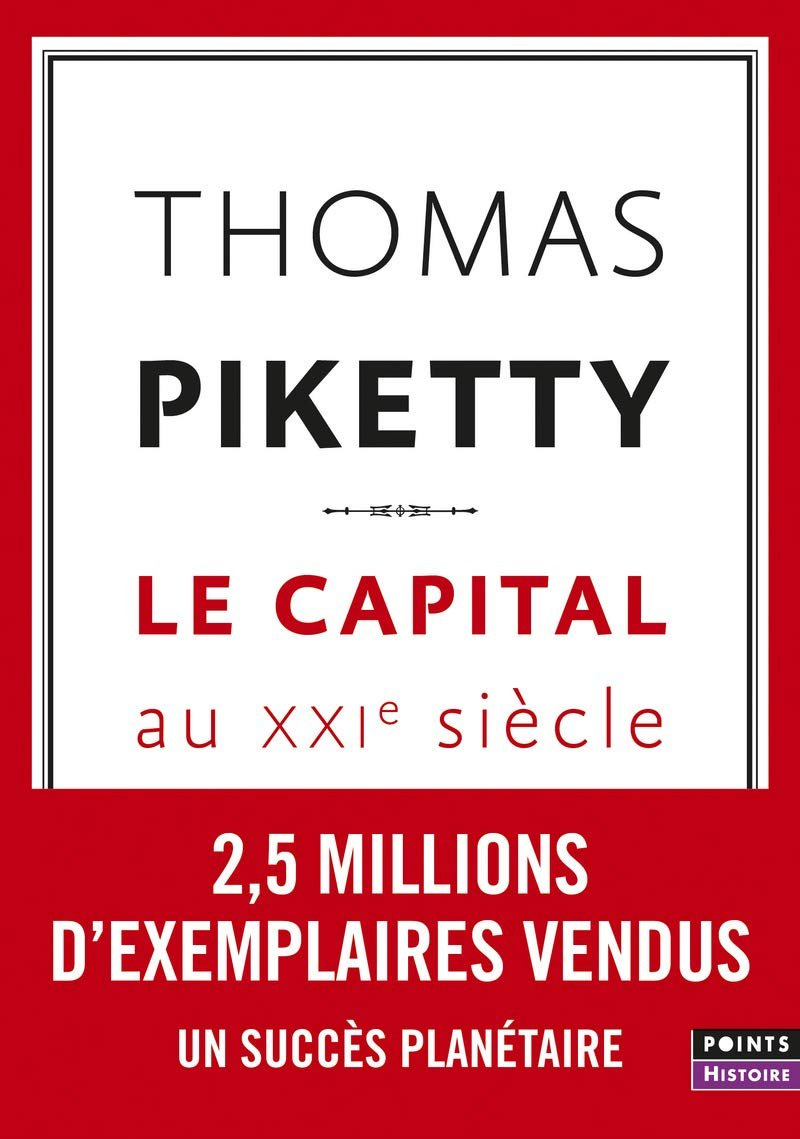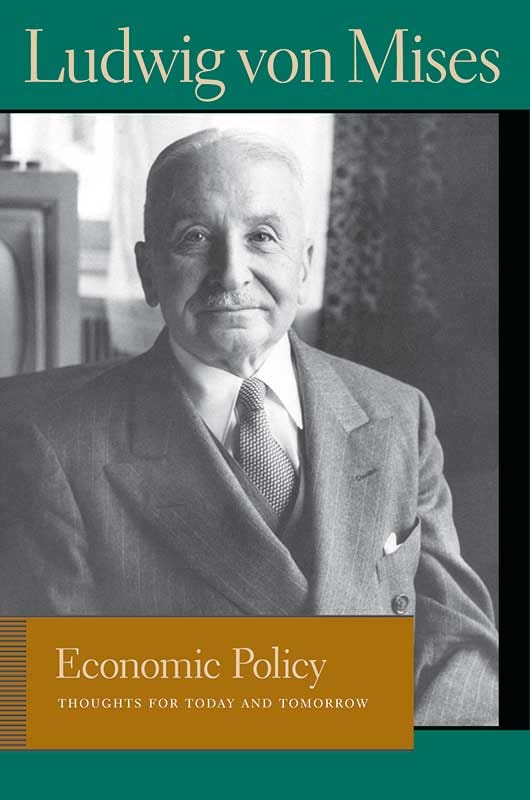Introduction
Dans mon fil sur le programme économique désastreux du Nouveau Front Populaire cumulant plus de 2.3 millions de vues, un commentaire est revenu en boucle :
🗣️ "Le programme du Nouveau Front Populaire est sérieux puisqu'il a été validé par plus de 300 économistes reconnus, dont l'excellent Thomas Piketty."
Ah ! On va avoir un problème...
Je vais m'attader dans ce fil sur Thomas Piketty, mais j'aurais pu évoquer d'autres noms, comme Gabriel Zucman ou Bernard Friot, deux économistes également encensés par la gauche française.
Mais plutôt que m'attarder sur les prix qu'on reçu les uns et les autres (les communistes en commentaires de mon fil semblaient très attachés au prestige), je vais plutôt me focaliser sur la démarche de Thomas Piketty, ses failles, et ce qu'elle révèle.
Je la mettrais en face de ma propre démarche, tirée de l'école autrichienne d'économie, pour que vous puissiez saisir la différence fondamentale qui nous oppose.
Qui est-il ?
Thomas Piketty est un économiste français qui s'est fait connaître par le biais de ses travaux sur les inégalités économiques et la répartition des richesses.
Il est l'auteur du livre "Le Capital au XXIe siècle" (2013) dans lequel il analyse les dynamiques historiques des inégalités de revenu et de patrimoine.
Dans ses écrits, il utilise une grande base de données historiques pour affirmer que l'intervention politique est nécessaire afin d'éviter la concentration du capital, elle-même à l'origine des inégalités économiques.
Il plaide notamment pour des impôts progressifs et différentes mesures de redistribution pour atténuer les inégalités observées.
1. Approche de Piketty et critique autrichienne
Thomas Piketty conçoit des analyses statistiques et empiriques pour étudier les revenus et patrimoines historiques, espérant ainsi évaluer l'impact des politiques économiques et fiscales sur la répartition des richesses.
L'école autrichienne (Carl Menger, Ludwig von Mises), dont je me réclame pour des raisons épistémologiques et méthodologiques (que nous aborderons dans la partie suivante), critique cette approche.
Les économistes autrichiens privilégient l'apriorisme à l'empirisme, soulignant que l'économie ne peut pas être comparée à une science expérimentale en laboratoire.
En effet, l'empirisme de Thomas Piketty ne permet pas de déduire des lois économiques universelles et infaillibles, car il est constamment mis en échec par le libre arbitre et la variabilité des préférences humaines.
L'économie ne peut se réduire à de simples relations statistiques car elles ne mesurent que des faits historiques spécifiques. Les tendances passées ne peuvent pas prédire de manière fiable les futures dynamiques économiques.
Pour creuser le sujet, visionnez cette vidéo :
Allons maintenant sur le terrain de l'épistémologie autrichienne pour justifier ces dires.
2. Justification de l'approche autrichienne
L'apriorisme philosophique nous enseigne que certaines connaissances sont indépendantes de l'expérience et peuvent être connues a priori, c'est-à-dire avant toute expérience. Certaines vérités sont considérées comme logiquement nécessaires et peuvent être établies par la seule raison.
Les autrichiens établissent alors l'économie comme une science apriori par le biais de la praxéologie, basée sur l'axiome de l'action humaine. Cet axiome est incontestable car il est impossible de le nier sans commettre une action en soi.
Nos actions sont intentionnelles et motivées par des préférences subjectives. Nul besoin d'observations empiriques ni d'essais erreurs en laboratoire pour l'affirmer. Nous ne sommes pas des fourmis : nous décidons, agissons, apprenons et évoluons.
À partir de cet axiome, nous dérivons des lois économiques par un processus logique rigoureux. Ce cadre nous permet de comprendre les phénomènes économiques à un niveau fondamental, en intégrant la complexité des choix individuels.
Par les lois économiques universelles qu'elle dégage, la démarche autrichienne résiste à l’épreuve du temps et aux contextes changeants. Elle offre une théorie incontestable (jusqu'à preuve du contraire), contrairement aux modèles empiriques.
Enfin, l'école autrichienne embarque avec elle un certain nombre de concepts comme la subjectivité de la valeur (déjà citée), la préférence temporelle, mais aussi une théorie du capital et de l'intérêt, de la monnaie et des cycles économiques. Cela permet aux autrichiens d'avoir un bagage économique complet et rigoureux dont l'analyse part toujours de l'individu.
3. Critique de la redistribution (forcée) des richesses
Thomas Piketty prône une redistribution obligatoire de la richesse, impliquant entre autres choses des politiques fiscales progressives imposées par l'État.
Mais cette approche pose plusieurs problèmes :
1. Violation des droits de propriété : la redistribution forcée constitue une violation des droits de propriété puisqu'il s'agit de confisquer des richesses légitimement acquises par les individus sans leur accord explicite.
2. Découragement de la productivité individuelle: quand l'individu sait qu'une partie conséquente de ses gains sera saisie par l'État, il n'est pas encouragé à prendre davantage de risques, à produire, à investir ni à échanger.
3. Distorsion des signaux du marché : la redistribution forcée perturbent les signaux économiques et entraîne une allocation inefficace des ressources.
4. Coûts administratifs : la mise en œuvre de politiques redistributives nécessite de la bureaucratie et génère des coûts administratifs élevés.
5. Entrave à l'accumulation de capital : la taxation réduit la capacité d'accumulation de capital des individus/entreprises, ce qui freine l'épargne, réduit les investissements et favorise une préférence temporelle individuelle tournée vers le présent (plutôt que l'avenir).
6. Problème de calcul économique : plus l’État intervient, plus la société devient socialiste économiquement, et moins le calcul économique est possible. Le marché libre est le seul à pouvoir faire émerger des prix libres par l’échange volontaire entre individus. La redistribution forcée participe de la montée de ce socialisme destructeur.
4. Critique de la lutte contre l'inégalité
Considérer l'inégalité comme un problème en soi est une erreur fondamentale. Les inégalités économiques en terme de monnaie résultent de différences de productivité, de compétences et de préférences individuelles. En tentant de corriger ces inégalités par des politiques de redistribution, l'État décourage l'initiative individuelle.
Pire encore, cela sape les fondations d'une société prospère en démotivant les éléments les plus productifs et générateurs de valeur, qui enrichissent pourtant toute la société. Si les récompenses économiques issues de la productivité n'existent plus, à quoi bon chercher à créer de la valeur sur place ? Autant aller ailleurs !
Il y a aussi des confusions entre inégalité et injustice chez un certain nombre de gens qui réclament de la redistribution (ici, je ne vise pas forcément Thomas Piketty). La justice consiste à rendre à chacun son dû, pas à redistribuer des richesses. Une inégalité n'est pas une agression.
En réalité, c'est à la notion de niveau de vie qu'il est préférable de se référer. Or, le marché libre favorise naturellement l'augmentation du niveau de vie par le biais de la production, de l'échange et des gains de productivité. Ce n'est pas la redistribution arbitraire des richesses qui sort l'Humanité de la misère, c'est la liberté du marché.
5. Thomas Piketty et l'État
Vous l'aurez compris, Thomas Piketty veut redistribuer. Mais pour ce faire, il doit passer par l'action de l'État. Il plaide donc pour un rôle accru de ce dernier dans la redistribution des richesses. C'est un point de différenciation majeur avec le libertarien que je suis, puisque l'État m'apparaît toujours comme illégitime et inefficient.
J'ai déjà décrit certaines des conséquences de cette redistribution forcée plus haut. Je vais donc plutôt creuser le cas Thomas Piketty. C'est à ce moment de l'argumentaire que je souhaite amener la logique des intérêts de classe. Je parle de la classe des hommes de l'État contre celle des éléments productifs du corps social. Thomas Piketty roule assurément pour la classe dominante, et il s'applique à fournir tous les éléments nécessaires pour légitimer l'action de l'État.
Bien sûr, il sera davantage sollicité par des partis de gauche que de droite. Mais qu'importe, c'est bien un argumentaire économique qui légitime et donne des pions idéologiques à l'État et à un possible gouvernement de gauche qui voudrait s'en saisir. De plus, son approche empirique truffée de chiffres donne des airs de sérieux. La mathématisation extrême de l'économie fait office d'argument d'autorité.
À l'inverse, quand j'écris et que je pose mes concepts, je le fais pour tous les entrepreneurs libres et indépendants. Je ne me compromets à aucun moment sur un plan politique. Thomas Piketty est un intellectuel d'État, pour reprendre l'expression fameuse du libertarien Hans-Hermann Hoppe.
6. Thomas Piketty et l'accumulation du capital
Thomas Piketty affirme que la concentration des richesses dans les mains de quelques uns est une tendance naturelle du capitalisme nécessitant intervention étatique pour éviter le creusement des inégalités. Mais tout comme l'inégalité n'est pas un problème en soi, l'accumulation du capital ne l'est pas non plus. Mieux encore, c'est en réalité un signe de prospérité.
Accumuler des ressources est un mécanisme de protection face à l'incertitude future. Le capital accumulé permet ainsi de se constituer une épargne pour de se projeter dans la vie. Une partie sera réinvestie dans la consommation et l'investissement, bénéficiant aux entreprises. Ce capital augmente alors leur productivité, permettant à des biens/services meilleurs et moins chers de voir le jour.
Autre point essentiel, Thomas Piketty ne voit pas que les plus fortes inégalités économiques proviennent de l'étatisme et non du marché libre. Les accumulations extrêmes perçues dans notre monde sont le plus souvent des phénomènes étatiques, pas des phénomènes de marché libre. Les milliardaires sont toujours ou presque en copinage avec l'État (le français Bernard Arnault est un très bon exemple).
Or, la collusion entre l'État et les entreprises n'a rien à voir avec le capitalisme de libre marché. Au contraire, dans un cadre de compétition libéré de l'État tel que défendu par les libertariens, chacun serait encouragé à produire, à innover et à échanger pour s'enrichir stimulé par la concurrence, loin des avantages injustes octroyés par l'État.
Accumuler, c'est se projeter. Accumuler, c'est élever son niveau de vie. Accumuler n'est jamais une coercition. Accumuler n'est jamais priver les autres, car la richesse est infinie, subjective et manifestée à l'échange. La seule violence vient de l'État qui nous empêche de jouir pleinement des possibilités de l'accumulation.
Conclusion
En résumé, Thomas Piketty est un économiste sérieux pour tous ceux qui veulent moins de richesses générées dans la société puisqu'il est clairement au service de politiques fiscales et redistributives non consenties. Je vous recommande donc de vous éloigner de cet idéologue d'État.
Tournez-vous plutôt vers le petit ouvrage "Six Leçons" de Ludwig von Mises pour vous mettre en douceur à l'économie. Pour les amateurs de la vidéo, sachez que j'ai transformé cet ouvrage en cours vidéo, et qu'il est accessible juste ici.