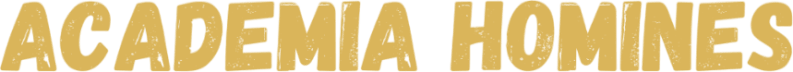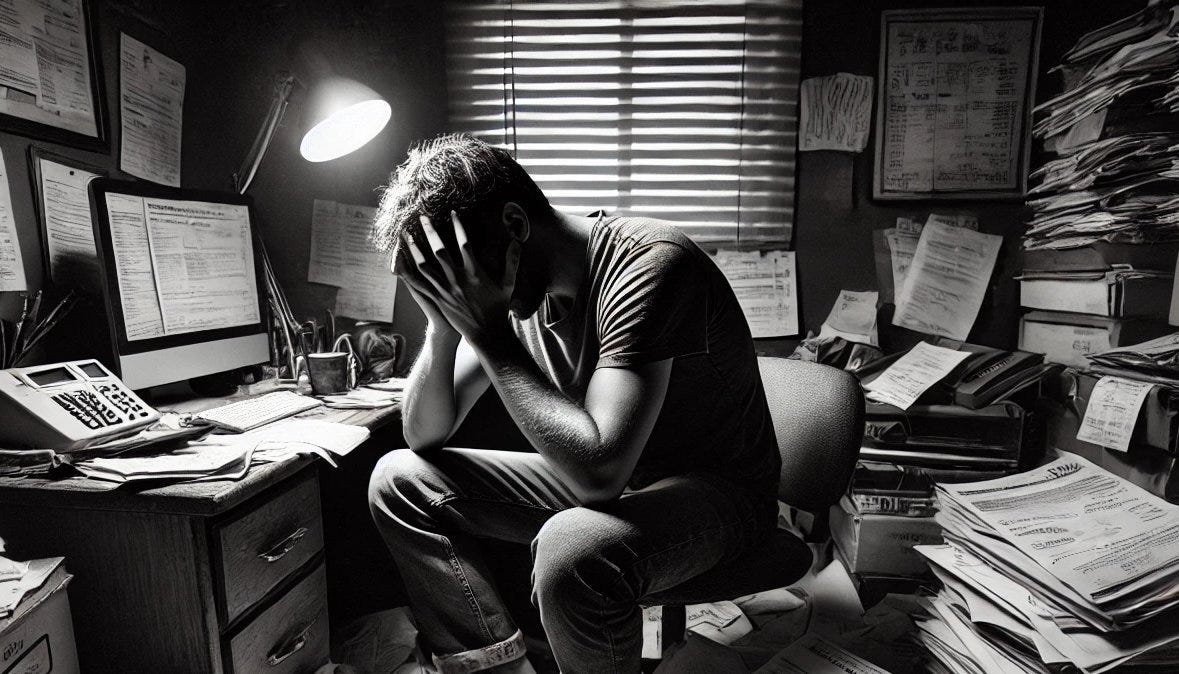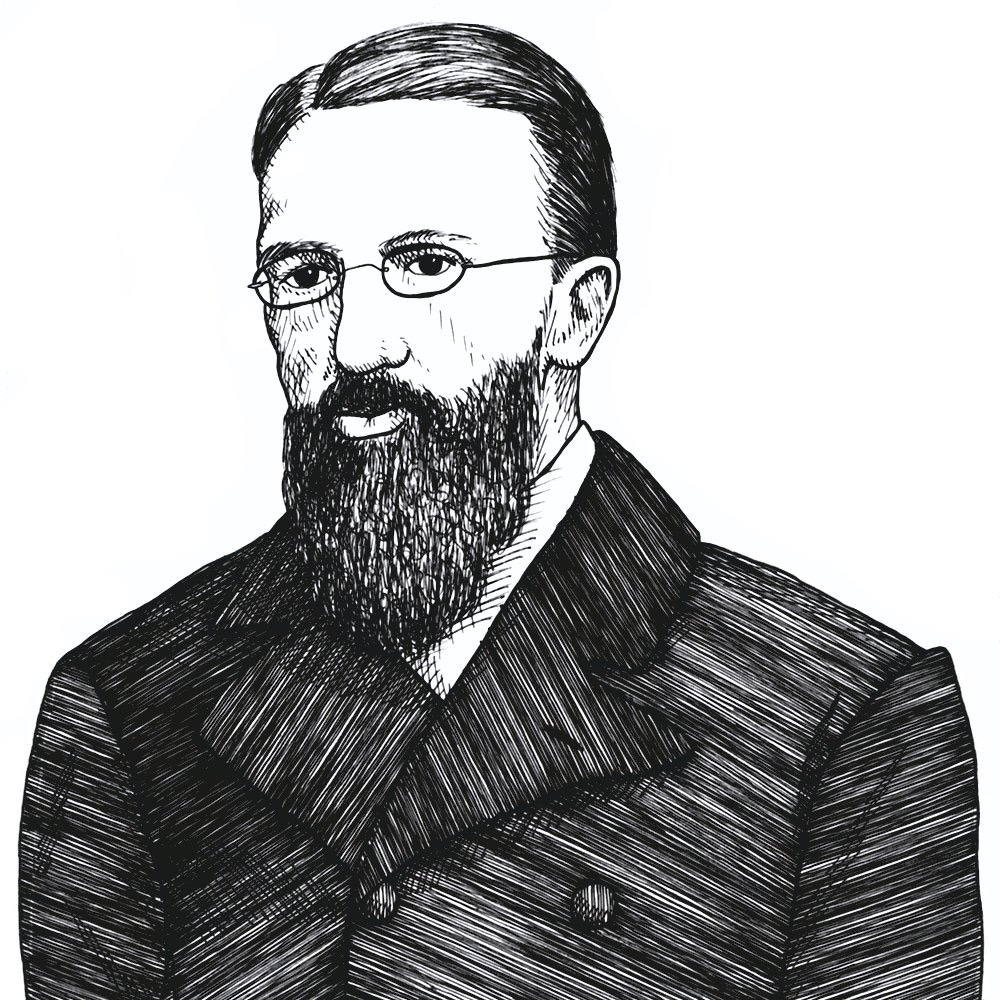Introduction
Certains la voient comme une simple suite de chiffres. D'autres se disent qu'elle n'est pas un problème.
⚠️ Pourtant, ses effets sont bien réels et dévastateurs.
Elle distord les marchés, écrase des populations entières sous le poids de l'asservissement économique et condamne les générations futures.
☠️ Bienvenue dans l'enfer de la dette publique !
1. Qu'est-ce que la dette publique ?
La dette publique correspond à l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunts par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement.
La dette publique évolue constamment au rythme des remboursements d'emprunts effectués par l'Etat et les administrations publiques et des nouveaux emprunts qu'ils contractent pour financer leurs déficits.
Source : https://www.economie.gouv.fr/
Après la définition, l'analyse ! Pourquoi la notion de dette publique est un problème ? Pourquoi l'État nous met-il en danger ? Quels sont les effets de la dette sur la civilisation ? Qu'en serait-il en toute liberté ?
Autant de questions auxquelles je vais m'efforcer de répondre tout au long de ce fil.
C’est parti !
2. Point de méthodologie
Commençons par une base méthodologique indispensable. Factuellement, il n'existe sur Terre que des individus. Cela n'est pas une opinion, mais une réalité tangible. Vous allez voir pourquoi je le rappelle.
Ensuite, l'État est à définir comme le monopole de la violence sur un territoire donné. Il détient sa propre force armée, crée le droit et lève l'impôt auprès de la population de ce territoire.
D'où le fait que :
1. La notion de dette devrait toujours être privée, jamais publique. Seuls les individus décident, agissent et sont responsables de leurs actes. Par extension, une entreprise peut contacter une dette, mais ce sont alors ses propriétaires, bien réels et responsables juridiquement qui en sont à l'origine.
2. Quand l'État s'endette, cela veut dire que ceux qui détiennent les moyens politiques prennent des engagements financiers "au nom de la nation", impliquant ainsi l'ensemble des actifs et contribuables du territoire. Grâce à leur position dominante, ils sont capables de les contraindre à assumer cet engagement.
Cela est inadmissible car coercitif. Tout individu devrait rembourser les dettes pour lesquelles il s'est engagé personnellement, jamais avoir à assumer d'autres dettes pour lesquelles aucun engagement n'a été pris.
3. Comment fonctionne le processus de création de dette ?
En bref, l'État émet des obligations qui sont en fait des titres de créance, promettant un remboursement avec intérêts. Ces titres sont vendus sur les marchés financiers à des investisseurs comme des banques, des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des particuliers.
Le taux d'intérêt de ces obligations dépend de plusieurs facteurs : les taux du marché, la perception du risque sur la question de la solvabilité de l'État, la durée de l'obligation, les anticipations d'inflation etc. Par la suite, les fonds obtenus par la vente de ces obligations sont utilisés pour financer les dépenses de l'État : salaires des fonctionnaires, programmes sociaux, projets d'infrastructure et autres grands travaux etc.
Par exemple, pour financer la construction d'une autoroute, l'État peut vendre des obligations et utiliser cet argent pour payer les entreprises et les travailleurs impliqués. Cela créera une demande artificielle pour les matériaux de construction, la main-d'œuvre et les services associés. Nous allons en reparler par la suite.
4. L'effet d'éviction
Abordons maintenant un premier aspect économique. La dette publique entraîne un phénomène appelé effet d'éviction. En fait, quand l'État emprunte massivement, il accroît de facto la demande de capitaux sur les marchés financiers. La loi de l'offre et de la demande s'applique partout.
Ainsi, il fait augmenter les taux d'intérêt et rend les emprunts plus coûteux pour les entreprises et les particuliers, qui sont pourtant les seuls créateurs de richesse de la société. Ils seront alors moins enclins à investir dans des projets puisque les taux sont moins avantageux.
De plus, les fonds prêtés à l'État sont toujours utilisés pour financer des projets publics qui ne reflètent pas les besoins réels du marché. Contrairement aux investissements privés qui doivent répondre aux exigences du marché pour viser la rentabilité, les projets de l'État échappent à cette nécessaire discipline.
Cela conduit à une allocation suboptimale des ressources puisque les capitaux sont détournés vers des usages politiques au lieu d'être utilisé vers des usages économiques. Les bienfaiteurs sociaux que sont les entrepreneurs se retrouvent alors freinés par cette coercition et le reste de la population en pâtit.
5. Fiscalité, monnaie & inflation
Pour rembourser la dette, les gouvernements augmentent les impôts sur le revenu, les bénéfices des entreprises et les taxes sur la propriété. Ils augmentent aussi les taxes sur la consommation (TVA, accises) pour collecter davantage de fonds, ce qui provoque souvent des colères sociales (c'est l'une des raisons des gilets jaunes et de la crise récente des agriculteurs).
En plus de la fiscalité, les États utilisent l'impression de monnaie pour rembourser leurs dettes. L'inflation qui en résulte réduit le pouvoir d'achat des citoyens en érodant la valeur de la monnaie et distord les marchés. Ce phénomène s'est normalisé après la disparition de l'étalon-or au profit des monnaies FIAT, mais aussi par le biais du développement des banques centrales et des États démocratiques. Pour en savoir plus :
L'État peut aussi adopter des mesures d'austérité pour réduire certaines dépenses publiques (services sociaux, éducation, santé etc) afin de libérer des fonds pour le remboursement de la dette. Bien sûr, je suis toujours favorable à la réduction des dépenses de l'État. Réduire les dépenses signifie moins d'argent volé aux productifs et plus de capital en circulation. Oui, sauf qu'il faut aussi laissez-faire le marché pour permettre l'émergence d'alternatives en remplacement des services publics en déliquescence. Hélas, France et libéralisation font rarement bon ménage…
Comment l'inflation détruit notre société ?
Bonjour à tous ! Ravi de vous présenter cette nouvelle vidéo privée sur le thème de l’inflation. Sommaire : 0:00 - Introduction 1:50 - Définition 4:34 - Effet Cantillon 6:26 - Côté histoire 10:44 - Conséquences de l’inflation 25:46 - Solutions libertariennes
6. Les cycles économiques
Parlons un peu plus des conséquences. Je l'ai dit plus haut, l'État injecte massivement les fonds dans l'économie pour ses grands travaux, ses programmes sociaux ou ses dépenses militaires. Mais comme disait le génial Frédéric Bastiat, "il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas". Cette prospérité est illusoire et insoutenable à long terme.
L'augmentation artificielle de la demande crée des inefficiences économiques car les capitaux sont alloués dans des secteurs qui seraient non viables sans l'intervention de l'État, ce qui mène à la formation de bulles économiques. Les prix des actifs (comme ceux de l'immobilier) augmentent alors de manière démesurée et commencent à attirer les investisseurs en quête de bonnes affaires.
Seulement, ces bulles économiques sont des bombes à retardement dans la mesure où elles ne reposent que sur la dette. Les investisseurs sont trompés par les prix artificiels des actifs et empruntent massivement pour les acheter, espérant une hausse continue du marché. Mais ce modèle est dangereux car il incite les emprunteurs à prendre des risques démesurés.
Quand les créanciers finissent par restreindre le crédit et que les banques centrales augmentent les taux d'intérêt pour contrer l'inflation, les emprunts deviennent plus coûteux et le prix des actifs chute. Les investisseurs paniquent et vendent massivement. Une crise de liquidité s'ensuit, plongeant l'économie dans la récession avec son lot de pertes économiques (chômage, faillites, etc).
7. La fin du principe de responsabilité
En empruntant massivement pour financer leurs dépenses, les gouvernements en exercice évitent d'augmenter trop fortement les impôts et de réduire les services publics, des mesures qui sont souvent jugées impopulaires et risquées pour leur carrière. Mais il y a une subtilité de taille liée à notre régime politique démocratique. Dans un tel cadre, les heureux élus sont en exercice sur de courtes périodes. Ils sont donc incités à privilégier des mesures populaires le temps de leur mandat pour ravir les foules et être réélus.
Ce faisant, le pouvoir reporte les conséquences économiques de ses actes sur les futurs gouvernements et les générations à venir. Par ailleurs, comme le coût total de la dette publique est réparti sur l'ensemble de la population, l'impact financier est dilué dans la masse, ce qui vient souvent atténuer sa gravité dans l'esprit populaire. Ajoutez à cela le fait que les électeurs sont bien peu renseignés sur les effets de la dette, et vous avez une combine parfaite pour masquer le vice de tous ces calculs démocratiques.
8. Un impact mondial
La dette publique peut avoir des répercussions internationales et notamment entraîner des crises de confiance parmi les investisseurs étrangers. Ces derniers surveillent de près la santé financière des pays pour s'ajuster en fonction du contexte.
Or, si un gouvernement accumule trop de dettes, les investisseurs exigeront des taux d'intérêt plus élevés, augmentant le coût du service de la dette. Mais une perte de confiance peut aussi provoquer des ventes massives d'obligations d'État, ce qui fait chuter leur valeur et entraîne une fuite des capitaux.
Dans les cas extrêmes, un défaut de paiement peut être déclaré, avec des conséquences dramatiques pour le pays et les investisseurs. Pour éviter cela, les gouvernements peuvent négocier le rééchelonnement de leur dette et se faire aider par des institutions internationales (FMI, UE) pour se stabiliser (prêts de sauvetage sous conditions de réformes).
Mais toutes ces stratégies ne peuvent être que court-termistes. Elles reposent sur des redistributions coercitives de ressources provenant du RNB (fausse mesure de la richesse, mais passons), de la TVA et des droits de douane des États membres. De plus, elles créent des dépendances au lieu de s'attaquer à la racine du problème : l'État lui-même et tous les organismes supra-étatiques.
En Europe, la Grèce est sans doute l'exemple le plus tristement célèbre de crise de la dette souveraine en 2008. Le pays a eu recours à des programmes de sauvetage internationaux et à des mesures d'austérité rigoureuses à l'origine de graves troubles sociaux et d'une récession prolongée. La folie de l'État a toujours des conséquences, tôt ou tard…
9. Un fardeau pour les générations à venir
Chaque euro (ou autre) emprunté aujourd'hui devra être remboursé demain, avec intérêts. Les gouvernements, en accumulant des dettes pour financer ses projets à court terme reportent alors ce coût sur les individus d'aujourd'hui, mais surtout de demain.
Ce fléau limite la capacité des générations futures à épargner et à investir dans leurs propres projets. Ainsi, la dette érode les perspectives de prospérité des générations à venir, les obligeant à porter le poids de la dette de l'État. Avant même d'être nés, nos enfants ont déjà une épée de Damoclès au-dessus de leur tête.
Autant dire que leur préférence temporelle sera directement impactée. Plus l'État continue dans cette voie spoliatrice et alourdit la note, moins nos enfants pourront former du capital, épargner, investir et réaliser tous leurs projets de vie. La dette les soumettra comme elle nous soumet déjà à une situation d'esclave par engagement financier forcé.
10. Une solution : la liberté !
Commençons par dire que l'objectif à viser est l'ABSENCE de dette publique pour aller vers de la dette strictement individuelle/d'entreprise. Je refais mon lien avec le début du fil, tout se recoupe.
Notez aussi un élément essentiel : la notion de dette existerait bien dans une société libertarienne, mais il n'y en aurait certainement pas autant. Cela pour diverses raisons : absence d'État et de banques centrales, préférence temporelle basse, taux d'intérêts naturels, pouvoir de la monnaie et épargne accrue, signaux de marché réels...
En situation étatique cela dit, trois principes fondamentaux devraient s'appliquer bien que cela soit peu probable compte-tenu de la tendance de fond et du fonctionnement des États démocratiques :
1. Réduire les dépenses publiques
En réduisant les dépenses publiques, l'État minimise le gaspillage et les inefficiences associées aux dépenses d'État. Les ressources qui restent dans la poche des entrepreneurs peuvent alors être redirigées vers des secteurs en demande sur le marché.
Des dépenses publiques plus faibles réduisent également les risques de volatilité économique tout en diminuant le besoin d'emprunter et de favoriser des crises de la dette souveraine.
2. Éviter l'endettement à tout prix
Éviter l'endettement signifie que les citoyens sont moins contraints par le fardeau de la dette à travers l'imposition et l'inflation. Une politique de non-endettement renforce aussi la confiance des investisseurs et attire des capitaux étrangers.
3. Laisser les marchés fonctionner librement
Enfin, en limitant l'intervention de l'État, les marchés peuvent fonctionner normalement. Les agents économiques en place peuvent alors déterminer les prix par l'offre et la demande afin d'allouer les ressources de manière optimale. Moins d'intervention signifie toujours moins de distorsions économiques causées par des subventions, des taxes et des réglementations.
Conclusion
J'ai commencé ce fil par une définition officielle, je finirais par la mienne :
Dette publique : forme sophistiquée d'asservissement politique qui force des populations entières à assumer des engagements financiers non désirés au nom du bien commun.