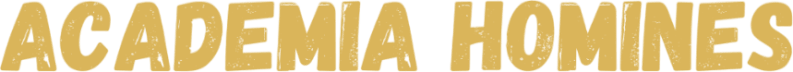Introduction
Imaginez un monde où chaque décision d'achat que vous faites façonne l'avenir de l'économie, où chaque entrepreneur est un explorateur en quête de territoires inconnus des désirs des consommateurs.
Non, ce n'est pas de la science-fiction, mais bien la réalité du marché et de la concurrence. Aujourd'hui, je vous invite à redécouvrir le concept de concurrence, coeur dynamique de l’innovation et de l’adaptation des entreprises.
La concurrence selon l'école autrichienne
La concurrence, selon l'école autrichienne d'économie, est envisagée non comme un état statique ou un idéal à atteindre, mais plutôt comme un processus dynamique, en perpétuelle évolution. Ce processus est animé par l'entrepreneur, figure centrale dans la théorie autrichienne, dont le rôle va bien au-delà de la simple production ou gestion d'une entreprise.
La concurrence comme processus de découverte
Pour les penseurs autrichiens, la concurrence est avant tout un mécanisme de découverte. Elle est le moyen par lequel les entrepreneurs explorent et révèlent les préférences cachées ou inexprimées des consommateurs.
Chaque entrepreneur teste ses hypothèses sur le marché, proposant de nouveaux produits, services ou modèles d'affaires, et c'est par le biais de ces expérimentations que les besoins réels des consommateurs sont progressivement découverts.
L'entrepreneur, acteur clé de la concurrence
L'entrepreneur est bien plus qu'un fournisseur de services ; il est un explorateur, un innovateur et donc un bienfaiteur social. En répondant aux désirs non satisfaits des consommateurs, il apporte de la valeur sur le marché et contribue donc au bien-être de ceux qui consomment ses produits/services.
Cette vision contraste fortement avec l'image parfois négative de l'entrepreneur dans d'autres cadres théoriques (notamment de gauche), où il peut être vu comme un capitaliste, grand gagnant d’un combat qui opposerait des riches et des pauvres (ce qui n’a aucun sens, l’économie étant le lieu des jeux à somme non nulle).
L'innovation au cœur de la concurrence
Dans le cadre autrichien, l'innovation est un aspect fondamental du processus concurrentiel. Les entrepreneurs sont constamment poussés à innover pour rester pertinents sur un marché où les consommateurs sont rois et donc pour continuer de réaliser des profits, marqueurs des services qu’ils rendent . Cette dynamique assure une amélioration continue des produits et services disponibles, conduisant à une élévation générale de la qualité de vie.
La concurrence imparfaite comme réalité bénéfique
Contrairement au modèle néoclassique de concurrence pure et parfaite, où l'homogénéité des produits et la transparence sont de rigueur, l'école autrichienne embrasse la concurrence imparfaite comme une réalité non seulement inévitable mais bénéfique. Les asymétries d'information et les différences entre produits stimulent l'innovation et la diversification, répondant ainsi plus précisément aux multiples facettes des désirs humains.
Exemple
Prenons l'exemple du secteur des télécommunications dans un pays où le marché est dominé par une poignée d'opérateurs ou, pire encore, un monopole d'État. Dans ce contexte, les consommateurs pourraient se retrouver avec des options limitées en termes de forfaits, une qualité de service médiocre et des prix élevés. L'introduction de nouveaux acteurs sur le marché pourrait briser ce monopole, amenant une vague de concurrence qui bénéficierait aux consommateurs par des prix plus bas, une meilleure qualité de service et une plus grande innovation.
Pour accéder à tous mes contenus, choisissez un niveau payant sur l’Académie.
Le problème des marchés fermés
Régression économique
Plus le marché est fermé, moins la concurrence est vivace, et moins le consommateur final peut y gagner. En effet, un marché fermé est caractérisé par des barrières à l'entrée élevées, qui peuvent prendre différentes formes : réglementations strictes, droits de douane élevés, quotas d'importation, monopoles légaux ou pratiques anticoncurrentielles. Ces obstacles limitent le nombre d'acteurs pouvant opérer librement sur le marché, réduisant ainsi la diversité des offres disponibles.
Dans un marché fermé, la concurrence est entravée. Avec moins d'acteurs sur le marché, l'incitation à innover, à améliorer la qualité et à réduire les coûts est diminuée. Les entreprises établies peuvent devenir complaisantes, sachant qu'il existe peu de menaces extérieures à leur position. Cette stagnation conduit à un environnement où l'évolution du marché est lente, limitant ainsi la disponibilité de nouvelles options pour les consommateurs.
Conséquences pour le consommateur final
Les conséquences d'un marché fermé sur le consommateur final sont profondes et nuisibles, reflétant l’intrusion délétère de l'État dans les mécanismes naturels du marché libre. Cette ingérence, souvent masquée sous des prétextes de protection ou de régulation, ne fait qu'entraver la souveraineté du consommateur et la dynamique essentielle de l'innovation et de l'efficience économique.
Premièrement, l'impact sur le choix du consommateur dans un marché fermé est immédiatement ressenti. Lorsque l'État impose des barrières à l'entrée, que ce soit par des régulations, des licences restrictives ou des monopoles dits légaux, il réduit de facto le spectre des options disponibles pour le consommateur. Cette limitation du choix n'est pas seulement une question de variété pour le consommateur, mais elle touche à l'essence même de la liberté individuelle. De plus, dans un marché ouvert et concurrentiel, les consommateurs exercent une pression constante sur les producteurs pour qu'ils innovent et améliorent leurs produits et services. Chaque transaction est un vote en faveur de la qualité, du prix et du service rendu. Mais dans un marché fermé, ce mécanisme démocratique du marché est étouffé, et le consommateur se retrouve à la merci d'une poignée de fournisseurs privilégiés par l'État.
Deuxièmement, les prix dans un marché fermé reflètent l'absence de concurrence. Sans la pression naturelle d'une saine concurrence, les entreprises établies sont libres d'augmenter leurs prix bien au-delà de ce qui serait possible dans un marché libre. Ces prix gonflés ne sont pas le résultat d'une valeur subjective en hausse chez le consommateur, mais plutôt une forme de taxation cachée, où les profits des entreprises protégées sont soutirés des poches des consommateurs ordinaires. Ce phénomène est doublement néfaste car il redistribue la richesse non pas sur la base de la valeur créée, mais en raison de la proximité de certaines entreprises avec le pouvoir.
Enfin, l'innovation et la qualité dans un marché fermé souffrent inévitablement. La concurrence est le carburant de l'innovation; elle pousse les entreprises à rechercher constamment des moyens d'améliorer leurs produits et de dépasser leurs concurrents. Lorsque cette dynamique est absente ou gravement restreinte, l'incitation à innover s'atténue. Les entreprises n'ont plus à lutter pour la faveur du consommateur par l'excellence; elles peuvent se reposer sur leurs lauriers, sachant que les barrières à l'entrée protègent leurs parts de marché. Cette stagnation ne se limite pas aux produits existants mais étouffe également la naissance potentielle de nouvelles idées et technologies qui auraient pu révolutionner des industries entières.
Conclusion
En conclusion, la vision autrichienne de la concurrence nous offre une perspective rafraîchissante sur le fonctionnement des marchés. Elle célèbre le rôle de l'entrepreneur en tant que force motrice de l'innovation et souligne l'importance de maintenir les voies de la concurrence ouvertes et libres d'obstacles illégitimes. La concurrence n’est pas un champ de bataille, mais bien un processus créatif qui pousse notre société vers de nouveaux sommets d'ingéniosité et de prospérité.