1929 et 2008. Deux dates gravées dans l’histoire économique comme les symboles de crises majeures.
Beaucoup affirment que ces événements sont une preuve de l'instabilité du marché, raison de plus pour l’encadrer davantage.
Mais laissez-moi vous dire qu’il n’en est rien.
😎 Promo estivale - Mon cours d’économie Six Leçons à prix réduit !
Pour l’occasion de la saison estivale, je relance mon cours d’introduction à l’économie "Six Leçons" basé sur l’ouvrage de Ludwig von Mises. J’y ai ajouté des compléments qui approfondissent les leçons déjà fournies, toujours dans cet esprit d’explications sans fioritures. Le cours a été conçu pour les débutants et les curieux.
Tarif estival :
37€ au lieu de 57€ sur ma plateforme secondaire
150€ en vous inscrivant au niveau avancé de l’Académie (Culture Liberté) : vous aurez ensuite accès à tous les cours suivants et à l'ensemble de mes contenus.
Contenu : 6 leçons de bases + 3 BONUS / environ 5h de vidéos
📅 Promo active jusqu’au dimanche 31 août
▶︎ Accéder au cours Six Leçons sur mon Académie (niveau Culture Liberté ; 150€)
▶︎ Accéder au cours Six Leçons à 37€ ma plateforme secondaire (au lieu de 57€)
📚 Au programme :
🎯 Les Six Leçons de Ludwig von Mises
Le capitalisme
Le socialisme
L’interventionnisme
L’inflation
L’investissement étranger
La politique et les idées
🎁 + 3 leçons bonus inédites
Leçon BONUS #1 : L’action humaine, l’échange et la valeur
Leçon BONUS #2 : La monnaie et les prix
Leçon BONUS #3 : La production, le capital et l’entrepreneur
Ces leçons bonus offrent une approche globale des enseignements de l’école autrichienne, en plus des chapitres thématiques de l’ouvrage de Ludwig von Mises.
▶︎ Accéder au cours Six Leçons sur mon Académie (niveau Culture Liberté ; 150€)
▶︎ Accéder au cours Six Leçons à 37€ ma plateforme secondaire (au lieu de 57€)
Quelques chiffres parlant
En 1929, les États-Unis voient leur PIB chuter de près de 30 % en quatre ans, une mesure peu pertinente certes, mais qui reflète tout de même bien l’effondrement massif de la production privée et de l’investissement à l'époque. Plus de 13 millions de chômeurs, une industrie à l’arrêt... un enfer économique.
En 2008, la capitalisation financière mondiale se contracte de plus de 50.000 milliards de dollars en quelques mois. C'est un effondrement de confiance. Les investisseurs vendent en masse. Les faillites bancaires s’enchaînent, le chômage explose et l’activité se contracte brutalement.
Deux séismes économiques mondiaux à 80 ans d’intervalle. Le coupable est vite désigné : le marché. Mais c'est un mensonge. Les crises ne sont pas des échecs du marché, mais les conséquences d’interventions étatiques. Ce fil vous exposera pas à pas la recette des crises économiques et les dessous de ces deux crises célèbres pour leur ampleur.
Ingrédient 1 : le crédit facile
Tout commence avec l’idée qu’il faudrait "stimuler" l’économie lorsque la "croissance ralentit". Sauf que ce seul présupposé contient deux erreurs majeures. D'une part, l’économie n’est pas un moteur collectif et homogène qu'il faudrait relancer par la force. Ensuite, la croissance est subjective et n'a de sens que si elle concerne chacun de nous.
C'est pourquoi la seule amélioration économique se mesure à l’échelle de chaque acteur selon ses objectifs et son appréciation de ce qui porte de la valeur. Le fait d'imposer une croissance macroéconomique (mesurée par des agrégats comme le PIB) conduit à ignorer l'individu et à user d'interventions qui perturbent l'ensemble du processus productif.
Concrètement, les banques centrales abaissent les taux d’intérêt en dessous de ce qu’ils seraient sur un marché libre. Pour rappel, un taux d’intérêt est le prix du temps. Il exprime le rapport entre la valeur que les individus accordent à une consommation immédiate et celle qu’ils accordent à une consommation différée.
En manipulant les taux à la baisse, les autorités monétaires changent la structure des coûts comme des opportunités. Le signal est donc faussé. Tout le monde pense que l'argent coule à flot, qu'il serait à la fois possible d'investir et de consommer en masse. Mais dans une économie non manipulée, ce phénomène est impossible :
- soit les gens épargnent plus et on peut investir davantage
- soit ils consomment plus et il y a moins d’épargne disponible pour financer des investissements
Quand le crédit est facilité, tout le monde se comporte comme si l’épargne existait en abondance, permettant à la fois d’investir et de consommer plus. Or, la création monétaire n’engendre aucune ressource ni aucune valeur. Elle ne fait que redistribuer du pouvoir d’achat en monnaie-fiat, diluer l’épargne par l’inflation et tromper les signaux du marché. Le résultat est inévitable : surconsommation, investissements mal orientés (nous allons y venir) et désynchronisation de toute la structure productive.
Ce qui veut dire que :
- Le crédit se répand à grande échelle alors même que l’épargne de l'économie productive (la consommation différée) n’a pas augmenté en proportion.
- L’épargne réelle devient moins attractive. Pourquoi retarder sa consommation si le rendement du capital est artificiellement bas ?
- L’endettement est favorisé. Les agents économiques sont incités à emprunter à faible coût, surtout pour des projets qu’ils n’auraient pas envisagés dans un contexte de taux de marché naturels.
Ingrédient 2 : les mauvaises allocations
Côté entrepreneurs, de nombreux agents économiques se lancent dans des projets qu’ils n’auraient jamais entrepris dans des conditions de marché non manipulées. Une effervescence qui n’est pas synonyme de prospérité, mais d’illusion généralisée.
Les entreprises investissent alors dans des secteurs à longue maturation, persuadées que les ressources nécessaires pour les soutenir existent et sont mobilisables. Mais en réalité, l’épargne qui devrait soutenir ces projets n’existe pas... tout est faux !
Côté consommateurs, ces mêmes taux bas encouragent l’endettement et la consommation immédiate. Ils ne réduisent donc pas leur consommation présente et prive le marché de l’épargne qui serait indispensable aux investissements engagés.
Tout repose sur de la monnaie-fiat et des conditions de marché artificielles. Les erreurs d’investissement s’accumulent donc, faisant croître la tension entre consommation et investissement. Mais tôt ou tard, les contraintes économiques réapparaissent et le retournement devient inévitable.
Ingrédient 3 : le retournement
Après cette phase d’euphorie monétaire et de mauvaises allocations vient celle du réajustement. Les lois économiques ne peuvent être suspendues par des manipulations monétaires. Ce retournement est déclenché par plusieurs phénomènes conjoints :
1. La remontée des taux d’intérêt : l’inflation devient trop forte pour être ignorée. Les banques centrales n’ont d’autre choix que de relever leurs taux et de réduire la création monétaire, ce qui met fin au crédit facile.
2. La saturation du crédit : beaucoup d’emprunteurs (ménages comme entreprises) sont alors lourdement endettés. Leur capacité à obtenir des crédits diminue car les banques deviennent plus prudentes.
3. La prise de conscience : les entrepreneurs comprennent que certains projets engagés pendant le boom ne produiront jamais les rendements espérés. Cette anticipation entraîne des ventes d’actifs, des arrêts de chantiers, des licenciements...
Peu à peu, les projets non viables se révèlent. Les bilans d’entreprises se détériorent. Les banques sur-exposées par le crédit commencent à vaciller. Les faillites se multiplient. Nous entrons dans le processus de correction. Le marché commence à liquider les erreurs accumulées pendant la phase d’illusion produite par injection de crédits.
Cette correction permet la réallocation des ressources vers des usages conformes aux préférences et aux contraintes du capital existant. Mais bien sûr, les gouvernements et les banques centrales l'empêchent par de nouvelles interventions. C’est à ce moment qu'apparaissent les renflouements, les rachats d’actifs et l’expansion monétaire encore plus agressive.
Cas d’école N°1 : 1929
Après la première guerre mondiale, la réserve fédérale américaine (Fed) adopte une politique de crédit facile dans une logique de relance économique. Les taux d’escompte (c’est-à-dire le taux auquel les banques commerciales peuvent se refinancer auprès de la Fed) sont maintenus artificiellement bas. Entre 1921 et 1929, la masse monétaire augmente même de plus de 60 %.
Les banques multiplient les prêts, tandis que la Bourse devient le terrain de jeu d’opérations à crédit de plus en plus risquées. Une part énorme des achats d’actions se faisait à crédit via des "margin loans". En clair, les investisseurs ne mettaient qu’une petite mise (souvent 10 %) et empruntaient le reste, les actions servant de garantie.
Mais à partir de 1928, la Fed relève fortement le taux d’escompte, passant de 3,5 % à 6 %. Le crédit devient donc plus coûteux, ce qui freine les prêts des banques, dont ceux utilisés pour financer ces achats d’actions à crédit. Moins de crédit signifiant bien sûr moins d’acheteurs pour soutenir la hausse des cours.
Lorsque le marché commence à reculer à l’automne 1929, la mécanique des appels de marge s’enclenche alors : les investisseurs incapables de remettre des fonds voient leurs titres liquidés de force. En quelques séances (Black Thursday, Black Monday, Black Tuesday), cette spirale se change en krach historique.
Hélas, la dépression est ensuite aggravée par les interventions étatiques :
- Smoot-Hawley Tariff Act (1930) : hausse massive des droits de douane, effondrant le commerce international.
- Hausse des impôts : sous Hoover, le taux marginal passe de 25 % à 63 %.
- Contrôle des prix et salaires : pression de Hoover, puis réglementations du National Industrial Recovery Act sous Roosevelt.
- Centralisation et monopoles : contrôle de l’or, interventions dans l’agriculture, création d’infrastructures et d’entreprises publiques comme la Tennessee Valley Authority, etc.
Comme l’a montré Murray Rothbard dans America’s Great Depression, la crise aurait pu être brève si les autorités avaient laissé le marché liquider les erreurs accumulées. Au lieu de cela, elles ont voulu "sauver" l’économie (toujours ce même narratif) par davantage d’interventions, ce qui a prolongé la dépression jusqu'à l'arrivée de la tragique seconde guerre mondiale...
Cas d’école N°2 : 2008
Après l’éclatement de la bulle internet en 2000 et le choc du 11 septembre 2001, la Fed de Greenspan baisse son taux directeur jusqu’à 1 % en 2003 et le maintient artificiellement bas pendant plusieurs années. Objectif ? Éviter la récession bien sûr ! Encore et toujours ces narratifs catastrophistes visant à créer la peur et cette vision constructiviste de l'économie...
Dans un contexte de dollar affaibli et de politiques d’expansion du crédit immobilier, les banques prêtent massivement à des ménages non solvables. Les garanties implicites de Fannie Mae et Freddie Mac combinées à la croyance que "l’immobilier ne peut pas baisser" encouragent des millions de foyers à s’endetter pour acheter des logements qu’ils n’auraient pas pu acquérir en conditions naturelles de marché.
Les établissements financiers empilent donc ces prêts risqués dans des titres complexes appelés Collateralized Debt Obligations (CDO). Ils regroupaient différents types de créances (prêts à la consommation, prêts étudiants, dettes d’entreprises, etc), mais dans les années 2000 ils étaient surtout adossés à des prêts immobiliers, dont beaucoup à haut risque (subprime).
Ces portefeuilles furent découpés en tranches selon le risque, puis vendus à des investisseurs. Les tranches dites "sûres" étaient souvent notées AAA, même lorsqu’elles contenaient une forte proportion de prêts très fragiles. Le système politico-bancaire de l'époque a bâti tout un mécanisme pour cacher les risques et les transférer à toute l’économie.
Les emprunteurs à taux variable ont donc vu leurs mensualités exploser, les défauts de paiement se sont accumulés et les prix de l’immobilier commencèrent à chuter. La bulle se dégonfla et entraîna une cascade de pertes. En septembre 2008, la faillite de Lehman Brothers gela le marché interbancaire et déclencha une panique mondiale.
Les images sont historiques. Rappelez-vous de ces employés quittant le siège de Lehman à New York (sur la 7e Avenue, Times Square) avec des cartons remplis d’affaires personnelles, les interviews d’anciens salariés sous le choc se multipliant dans la rue, etc. La réponse des autorités ne tarda pas :
- Sauvetages massifs (bailouts, nationalisations)
- Plans de relance à crédit
- Expansion monétaire sans précédent (quantitative easing, taux zéro puis négatifs après 2014 en Europe et au Japon)
Comme en 1929, cette crise fut le résultat d’un boom artificiel provoqué par une politique monétaire expansionniste et non d’un "laisser-faire destructeur" de marché. Quand la monnaie est manipulée par les États et les banques centrales, les crises ne sont pas des accidents… ce sont des nécessités du système. La crise est provoquée par conception politique, non parce que le marché lui-même aurait des failles à corriger.
Perdu pour tout le monde ?
Non, bien sûr que non ! La manipulation du crédit est une stratégie d'enrichissement pour les castes politico-bancaires en place. Une crise artificielle est toujours une redistribution cachée. À chaque cycle :
1. Le boom enrichit d’abord ceux qui sont les plus proches de la source du crédit : grandes banques, fonds spéculatifs, États surendettés, multinationales sous perfusion monétaire etc. C'est l'effet Cantillon.
2. La crise frappe ensuite les plus éloignés : épargnants, petits entrepreneurs, salariés, classes moyennes... bref, la quasi intégralité du tissu économique productif.
3. À cela s’ajoute la gestion politique qui aggrave encore les déséquilibres. Les grandes entreprises sont sauvées au nom de la stabilité et les banques centrales rachètent les dettes publiques. Pratique !
Qu’en conclure alors ? Et bien, qu'une crise économique systémique/mondiale... ça n’existe pas sur un marché. Il n’existe que des transferts d’argent du bas vers le haut, du marché vers l’État, de la production vers la dette. Toute crise est un vol organisé. Toute crise est politique. La crise, c'est l'État et ses alliés.

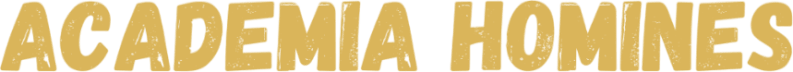








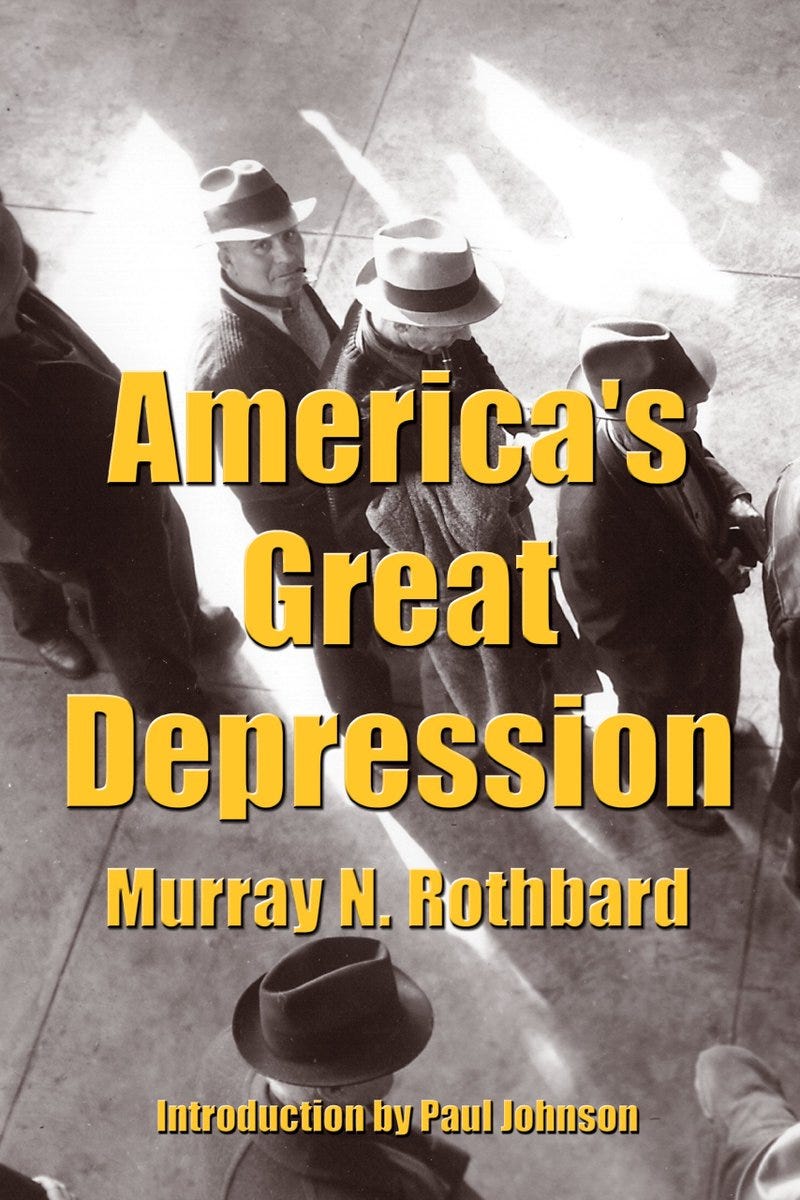



Merci pour cet article qui permet d’appréhender en ”quelques” lignes les processus à l’œuvre dans les crises qu’ ”on” nous mitonne....
Si ce n’est déjà fait par ailleurs, puis-je traduire votre article en anglais et le reposter ? (en vous citant et en mettant le lien vers votre article, of course !)